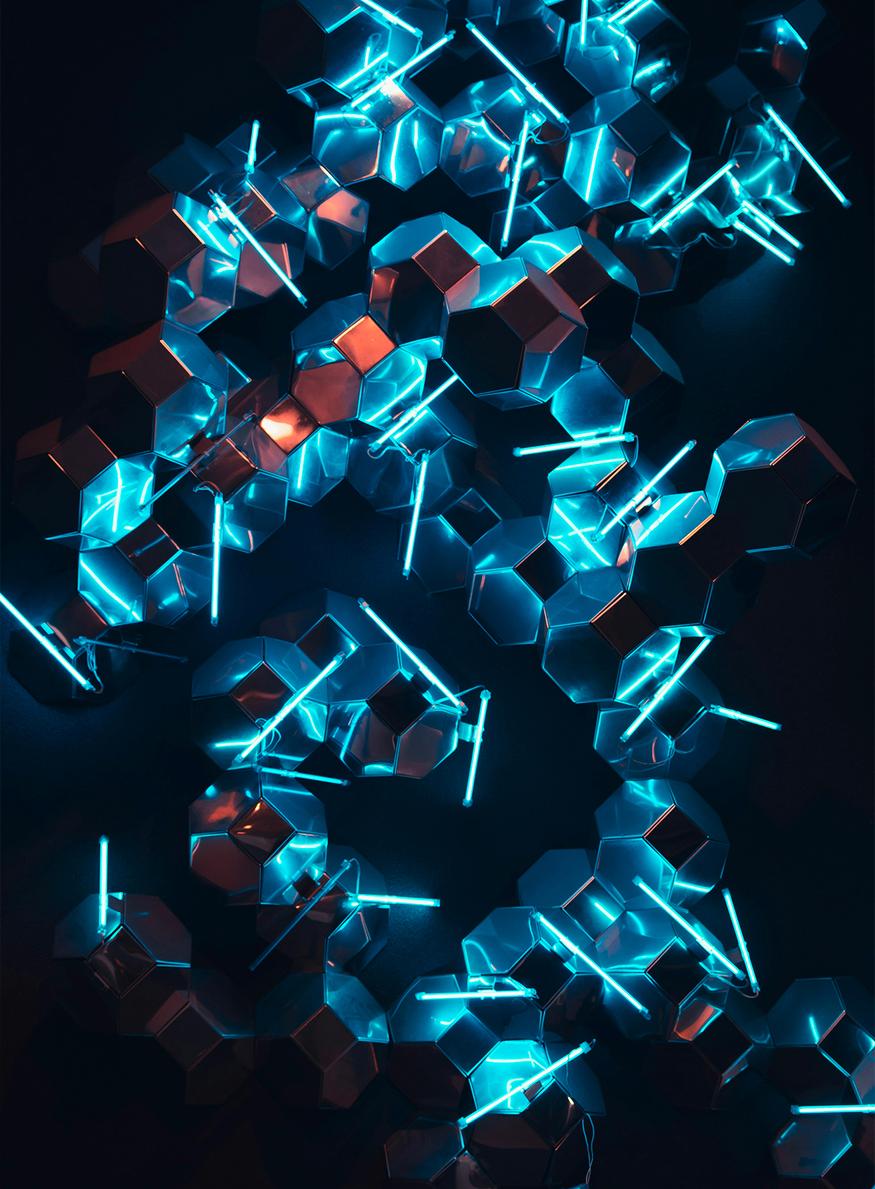
Chronique
Le masque ou le prompt : l’IA redéfinit le geste créatif dans le luxe
Publié le par Laurent François
À l’occasion de la sortie de son nouveau livre – Cracker l’algorithme, réeenchanter les réseaux sociaux (L’Aube), Laurent François revient sur l’utilisation visible de l’intelligence artificielle générative dans les communications des marques.
Partenariats technologiques, campagnes dopées aux algorithmes, expositions médiatiques : jamais l’industrie n’a semblé aussi fascinée par les promesses d’une création automatisée. Pourtant, cette effervescence cache une interrogation stratégique essentielle : faut-il rendre visible l’usage de l’IA dans les communications des maisons, ou au contraire la cantonner à un rôle d’assistante invisible ?
Le danger de l’"algofluence" : la tyrannie de la standardisation algorithmique
La question ne peut être tranchée simplement. Car derrière l’apparente modernité de l’outil, se dissimule le risque de l’"algofluence", cette influence algorithmique qui agit comme une gravité invisible, attirant les contenus vers ce qui a déjà été validé et popularisé. Les réseaux regorgent d’images spectaculaires générées par IA, d’une virtuosité technique indéniable, mais souvent vides de sens. En suivant les codes prédictibles des algorithmes, les marques produisent des visuels interchangeables, vidés de singularité, qui certes "engagent" de façon quasi mécanique. Mais qui détournent l’essence même d’un luxe qui repose sur la rareté, la profondeur symbolique et la différence.
Montrer l’IA de cette façon, comme un gadget démonstratif, revient à affirmer que la créativité est reproductible, une antithèse des valeurs du secteur qui ne peut se contenter d’un copié-collé de prompts. Surtout quand le luxe vit une crise de valeur perçue.
Plus profondément encore, l’IA menace parfois l’expérience du hasard, de la quête et de la joie. L’œuvre Drone in Search for a Four-Leaf Clover de l’artiste Sputniko! illustre ce paradoxe : des drones équipés d’IA scannent des champs entiers pour identifier automatiquement les trèfles à quatre feuilles. Le geste de la recherche, l’attente, l’accident heureux qui faisaient le charme du rituel disparaissent, remplacés par l’efficacité d’un calcul. L’émotion du hasard se dissout, comme un joueur qui activerait un cheat code dans un jeu vidéo pour éviter la difficulté pour passer un niveau. Le prix à payer est élevé : faire disparaître la satisfaction profonde d’imposer une certaine éducation au beau, la friction nécessaire pour comprendre les codes du luxe, et partant la possibilité de transmettre ce savoir de communauté en communauté.
L’IA comme matériau
Pour autant, réduire l’IA à une menace serait injuste. Des expériences récentes démontrent que son intégration augmente la productivité créative et renforce la valeur perçue des œuvres lorsqu’elle est employée avec rigueur d’après des chercheurs de la Tilburg University. Stratégiquement, un dialogue continue entre les créateurs et les IA nourrit un espace vif qui contrecarre le risque de standardisation progressive puisque la création visuelle ne s’en remet pas uniquement à la machine mais aux gestes de l’humain.
Autrement dit, l’IA exploite et accélère, mais n’invente pas ; elle propose, mais ne décide pas. Dans l’univers du luxe, c’est précisément ce filtrage humain, ce tri exigeant et cette intention artistique qui donnent sa force à l’œuvre.
De là naît une scène inédite : celle de l’"artiste IA". Contrairement à l’usage purement utilitaire ou marketing, certains créateurs revendiquent l’IA comme un véritable médium. Paul Mouginot, alias aurève vettier, en fait une matière première qu’il façonne, détourne et sculpte, à la manière d’un peintre avec ses pigments. Le prompt n’est qu’un point de départ ; l’essentiel se joue dans l’itération, le bricolage, la tension entre la logique calculatoire et l’imaginaire humain. La machine propose, l’artiste oppose, sélectionne, oriente. De cette dialectique naît une vision, une écriture visuelle singulière. Pour les maisons de luxe, collaborer avec de tels artistes revient à ne plus montrer l’IA comme un gadget, mais comme le signe d’une démarche culturelle authentique, un geste rare et porteur de sens. L’image produite est un prétexte à expliquer sa genèse, tout le travail de curation et de plongée dans les archives. Elle devient un manifeste profondément humain.
À l’inverse, certaines maisons préfèrent emprunter la voie de la discrétion, en adoptant une approche de quiet tech où l’IA agit en coulisses, derrière un masque. LVMH illustre cette philosophie en faisant de l’intelligence artificielle un catalyseur invisible : elle fluidifie les échanges entre création, data et stratégie, affine les campagnes, accélère la circulation des idées, mais sans chercher à imposer sa visibilité. Dans ce modèle, l’IA n’est pas l’œuvre, elle est l’atelier. Elle n’est pas l’affiche, elle est la coulisse. Loin de remplacer la vision, elle en devient le support silencieux.
Éduquer à un nouvel art ?
Du point de vue des clients, les mentions "créé avec l’IA" ou "création assistée par IA" peuvent dévaluer a priori un visuel. Une méfiance légitime puisqu’elle puise sa source sur la valorisation du temps long, du geste artisanal et de l’imperfection humaine qui rend une œuvre unique. Les débats autour des images retouchées ont sans doute aussi préempté cette perception. Et le récent bad buzz contre J. Crew qui n’avait pas mentionné l’utilisation de l’IA pour une campagne se reposant sur une certaine esthétique nostalgique prouve à quel point le sujet est sensible.
L’aura d’une création de luxe vient de son histoire, de la main qui l’a façonnée ; la réduire à une simple instruction machine, un prompt, menace de briser ce pacte de valeur.
Cette perception change radicalement lorsque le récit se déplace de l'outil vers le processus. En expliquant la démarche comme la curation, les centaines d'itérations rejetées, la vision artistique qui guide le dialogue avec l'algorithme, la maison ne vend plus une image, mais une performance créative. Elle éduque son public à une nouvelle forme d'artisanat numérique, où la maîtrise du prompt et de l'outil devient un geste aussi signifiant que celui du pinceau. Coperni a ouvert la voie notamment en 2023 avec son interprétation du conte "The Wolf and The Lamb" où 6 mois durant plus de 320,000 versions de la vidéo ont été générées par AI, ce qui fait partie d’une vision stratégique au long cours. L’IA – et la technologie – invitent à disrupter les catégories, au service de produits toujours plus aspirationnels pour une clientèle luxe. Il est nécessaire d’éduquer à ce nouvel art, encore extrêmement opaque en dépit de la démocratisation des outils.
L’intention créative, le vrai sujet stratégique
On comprend dès lors que la question pour le luxe n’est pas de savoir s’il faut montrer ou cacher l’IA, mais dans quel but. Sa visibilité n’a de sens que lorsqu’elle est porteuse d’intention, inscrite dans un récit culturel ou artistique. Sa discrétion, elle, ne vaut que si elle renforce la cohérence stratégique et la profondeur de l’expérience. La tentation de voir dans l’IA une réponse magique est une illusion, comme le souligne ironiquement Demi Moore dans la dernière campagne Gucci : "I thought that one AI was gonna fix it". Non, l’IA ne réparera rien par elle-même. Mais elle peut devenir, d’un côté, un partenaire stratégique invisible, et de l’autre, le pinceau d’une nouvelle génération d’artistes.
Le véritable enjeu pour les maisons réside dans cette navigation subtile entre deux mondes. Savoir utiliser l’IA en coulisses pour garantir pertinence et rapidité, et collaborer avec des artistes IA pour offrir des performances porteuses de sens. Là se joue peut-être l’avenir du luxe : non pas dans une fascination naïve pour la technologie, mais dans la capacité à la domestiquer, à l’inscrire dans une éthique visuelle, à transformer l’algorithme en un espace de rareté. L’IA devient alors non plus une démonstration de puissance, mais une heuristique créative, une voie nouvelle vers l’exception. Le masque et le prompt réunis au service de la vision stratégique de la Maison.
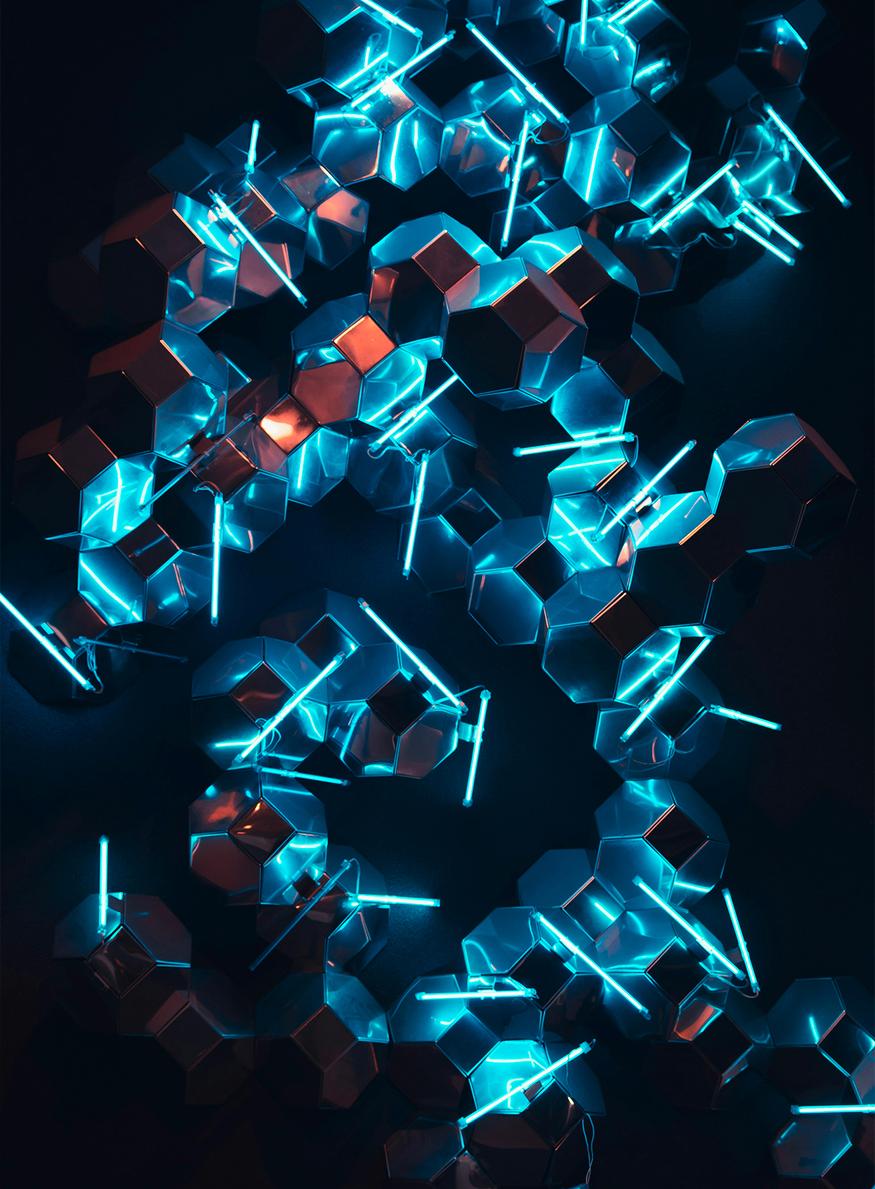
Chronique